Qui s’attendait à cette mobilisation contre la loi Travail ? À ce moment-là ? Peut-être à une journée de manif sans lendemain, mais pas à des mois d’un mouvement rampant. Mais y a-t-il vraiment de quoi se réjouir ?
Certains ont évidemment trouvé ce
mouvement enthousiasmant parce qu’ils ont lutté et y ont pris du
plaisir. Causer des nuits entières, casser une vitrine, comploter, humer
la lacrymo ou le pneu brûlé à plus pouvoir respirer, rencontrer des
copains, des camarades ou des amants, etc., de quoi vouloir que cela ne
s’arrête pas… C’est ce que l’on ressent après s’être fortement impliqué
dans ce genre de mouvement. C’est ce que ne ressent donc, en général,
qu’une minorité. Mais il faut bien le reconnaître, ce coup-ci, cette minorité est bien plus réduite que lors des luttes précédentes.
N’ayant pas d’organisation ou de parti à construire, pas d’échéance
électorale en vue, nous n’avons pas besoin de (nous) mentir pour
« garder l’espoir » et voudrions ici tenter d’y voir un peu plus clair,
du moins sur quelques points.
Et d’abord, pourquoi « ça a pris » cette fois-ci ? La contestation de la loi El Khomri naît dans une ambiance de fin de règne : celle de Hollande, du « socialisme » ou de la démocratie, on ne sait trop. Sombre atmosphère faite de ras-le-bol et de cafard généralisés, de sourde colère de la population, le tout saupoudré d’attentats. Avec une sale impression de voie sans issue, puisque c’est un gouvernement « de gauche » qui met en place les mesures qui font rêver le MEDEF(1). Même ceux qui ont en tête le retrait du CPE il y a dix ans, savent que l’abandon de la loi Travail serait une victoire limitée et provisoire et qu’à partir de 2017 ça sera pire. Il n’y a semble-t-il pas d’espoir, même plus celui d’une victoire de « la gauche »… Et c’est d’ailleurs une grande nouveauté qu’un mouvement de ce type affronte un gouvernement « socialiste »(2), censé défendre les intérêts de ses électeurs (les travailleurs). On aurait pu croire qu’à un an d’une élection le pouvoir voudrait teinter son image d’un soupçon de gauche et que, après quelques passes d’armes avec la CGT, il concéderait une modification superficielle du projet qui pourrait satisfaire la rue. Eh ben non, même pas ! Certaines illusions se dissipent, c’est le point positif, et des dizaines de locaux du PS sont d’ailleurs pris pour cible, dégradés et tagués par des manifestants.
Des mobilisations
Le mouvement est d’abord caractérisé par
une très faible mobilisation qui n’atteindra jamais les niveaux de 2010
ni de 2006, puis par son hétérogénéité en fonction des lieux ou des
secteurs d’activité. Dans de nombreuses villes, surtout moyennes, on
n’avait jamais vu de mémoire de militants une aussi faible
participation… Idem en ce qui concerne les lycées et universités qui ne
sont que très peu touchés, en particulier les lycées professionnels qui,
en d’autres temps, formaient une large part des cortèges informels,
manifs sauvages et débordements.
Manquent aussi les fonctionnaires (non concernés par la réforme
contrairement à 2010), les chômeurs et précaires, d’une manière générale
la large partie des travailleurs qui subit déjà la précarité (pour eux
le Code du travail est déjà contourné) et notamment les habitants des
quartiers dits « populaires ».
Mise à part Nuit Debout (ND) qui amalgame autour de noyaux militants une
frange perdue de la classe moyenne (dont une part ne fréquente pas les
manifestations), la mobilisation concerne principalement les militants
et les travailleurs syndiqués, les habituels habitués. De plus, si
certains s’opposent aux conséquences de la loi Travail dans leurs
branches et si des salariés sont en même temps engagés dans des luttes
spécifiques (cheminots par exemple), beaucoup ne viennent aux manifs que
pour « exprimer » leur ras-le-bol.
La faible participation entraîne mécaniquement un très faible impact : zéro conséquence sur la production, les flux de marchandises ou de travailleurs… D’où un recours accentué aux actions symboliques, qui le sont de plus en plus, des blocages qui bloquent de moins en moins, une pénurie de carburant qui n’a de réalité que dans les médias, etc. Sans rapport de force avec le gouvernement, les seuls « points forts » restent donc les journées de démobilisation, quatorze, qui se succèdent sur sept mois. La participation fluctue et décroît et, comme à chaque fois, on se dit que quatorze journées de grève d’affilée auraient eu plus de gueule.
CGT mon amour…
Pas plus qu’elle ne trahit les travailleurs (elle fait son job), la CGT ne les manipule à des fins propres. Il n’y a pas de complot ; même s’il existe évidemment des négociations discrètes, des tambouilles internes et des stratégies qui nous échappent et donnent parfois cette impression d’entourloupes (conflits entre confédérations, fédérations ou syndicats, rivalités entre unions locales et départementales, luttes entre tendances, etc.).
En ce début d’année la CGT pâtit d’une image pourrie à cause de l’affaire Lepaon et se trouve en perte d’influence, d’élus et d’adhérents. La base, dont l’aile gauche se renforce, veut un appel à la grève générale, d’autant que la loi Travail comporte des dispositions mettant à mal le rôle des syndicats (notamment l’inversion des normes). La tension est sensible lors du 51ème Congrès confédéral qui se tient à Marseille du 18 au 22 avril 2016.
Sans doute surprise par la fermeté du gouvernement et par l’ampleur du mouvement auquel, de facto,
se trouve lié son agenda, la direction du syndicat se doit de réagir.
Il s’agit de satisfaire la base mais aussi de préparer les élections
professionnelles de 2017 (c’est le propre de toute organisation que
d’assurer avant tout sa survie).
La CGT a la capacité, sur une décision et en quelques mails, de lancer
dans la grève de nombreux secteurs… mais pour ce qui est de la faire
durer, c’est beaucoup plus incertain. Un échec dans ce domaine serait
une catastrophe. Tout en expliquant qu’une grève générale « ne se décrète pas » (ce qui est vrai)(3),
la direction adopte un discours contestataire mais ne lance dans la
grève que certains bastions où des questions spécifiques sont en jeu et
peuvent déboucher sur des victoires partielles : l’Énergie le 24 mai,
les cheminots le 31 mai, la RATP le 1er juin, etc. Une carte de la
sectorisation, en ordre dispersé, que joue également le gouvernement.
La CGT doit aussi montrer qu’elle est l’interlocuteur incontournable
qui, à partir du moment où elle entre en scène, maîtrise le mouvement,
les boutons on/off, grève/reprise, blocage/déblocage et assure la bonne
tenue des manifestations. D’où le déploiement d’un service d’ordre avec
casques, battes de base-ball et gazeuses à Paris pour y rétablir un
contrôle « à l’ancienne », sans d’ailleurs bien comprendre l’émergence
d’un nouveau rapport à « la violence » dont nous parlerons plus loin.
Pourtant, malgré les reculades
successives de Martinez, Valls reste inflexible et ne fait aucune
concession, ce qui explique en partie, comme en 2010, la longueur du
mouvement. L’annonce d’un accord gagnant/gagnant qui aurait permis une
sortie de crise honorable pour chacun n’est jamais venu. Valls y a
peut-être vu là l’occasion de porter un coup fatal à la CGT et à la
gauche du PS tout en satisfaisant le MEDEF.
Les syndicats sont depuis bientôt un siècle un rouage crucial du mode de production capitaliste ; des organisations ouvertement
collabos comme la CFDT, en progression, sont, semble-t-il, jugées
suffisantes pour encadrer une classe ouvrière défaite. Mais qu’en
sera-t-il demain ?
Autonomie ?
Il y a tout d’abord eu cette impression, presque un soulagement, lorsque la CGT est entrée en scène : « la chose est devenue sérieuse ». C’était en mai, lorsqu’à l’appel du syndicat plusieurs secteurs entraient progressivement en grève reconductible. Un engagement tardif, à reculons, et un discours ambigu quant à la loi Travail, ont fait croire à certains que, malgré sa faiblesse, le mouvement avait été radical car « autonome » depuis février…
C’est sur les réseaux sociaux qu’a débuté
en février 2016 une mobilisation (pétition et youtube) qui a pour
origine l’aile gauche du PS (ou à sa gauche) et a pour cadre les
affrontements entre diverses tendances d’une social-démocratie en
décomposition.
Le mouvement contre la loi Travail qui débute réellement le 9 mars 2016
reposera en premier lieu sur une succession de « journées nationales de
mobilisation » auxquelles appelleront à chaque fois une foultitude
d’organisations syndicales et politiques. Son calendrier est calqué sur
celui que suit le projet de loi entre Assemblée Nationale et Sénat. Ces
journées, week-end mis à part, sont aussi des journées de grève (certes
très faiblement suivies). Les syndicats sont donc là dès le début pour
encadrer le mouvement. Les seuls à prendre un peu de liberté ont été les
étudiants et surtout les lycéens qui doivent néanmoins se coltiner les
organisations « de jeunesse », c’est-à-dire UNEF, UNL, FIDL, ou même les
« Jeunesses communistes » (sic) qui resurgissent par endroit, allez
savoir pourquoi(4) !
Il y a certes ND, mais l’on sait que l’initiative a été lancée par des militants pro-Mélenchon avec l’appui de vieilles orgas citoyennistes toujours utiles comme le DAL ou la CIP, puis envahie par des militants de toutes obédiences(5). Bien que liées au mouvement contre la loi Travail, les ND en sont tellement restées en marge qu’il est difficile d’y voir des organes de lutte.
La lutte de 2010 avait, elle, vu l’éclosion dans de nombreuses villes
d’« assemblées de luttes » ou « AG interpro », expression autonome du
mouvement qui y rassemblait de modestes franges (surtout des militants)
lassées des manœuvres syndicales. Beaucoup avaient imaginé que ce
phénomène, au fil des années, irait croissant ; mais au printemps 2016
elles furent bien rares et une tentative de coordination nationale n’y a
rien changé. Si cela n’explique pas tout, il faut noter que les ND ont
souvent laissé peu de place aux autres (dans certaines villes les deux
types de regroupement cohabitent néanmoins, comme à Marseille ou à
Alès).
On comprendra qu’il nous semble assez présomptueux de caractériser ce mouvement par sa radicalité et son autonomie. C’est bien regrettable mais assemblées de lutte, AG interpro ou « cortèges de tête » n’ont pu exister que par rapport et grâce au cadre créé par l’intersyndicale. Et voir dans la marginalisation croissante de la CGT une victoire de l’autonomie prolétarienne contre la bureaucratie serait abusif et trompeur(6). Les différents mouvements des années 1970 et 1980 portés par des coordinations (cheminots, infirmières, etc.) ont d’ailleurs montré qu’on pouvait très bien se passer des syndicats… pour faire du syndicalisme.
Violence ?
Si un point en a surpris beaucoup, c’est le rapport à la violence de certains participants au mouvement.
- D’abord la « violence » elle-même (contre les biens matériels et les flics) : en queue et en tête des manifestations de Paris et de quelques grandes villes (dont Nantes et Rennes) ou bien lors de manifs sauvages partant de la place de la République, les dégradations et leur récurrence ont atteint un niveau surprenant pour la France. Cela reste difficile à évaluer d’un point de vue quantitatif ou qualitatif et le riot porn n’y aide pas. Bien que l’affrontement avec les forces de l’ordre conservent un caractère ritualisé c’est bien une pratique qui semble se diffuser (techniquement l’innovation réside surtout dans la généralisation de dispositifs défensifs comme banderoles renforcées, masques et lunettes).
- Le rapport aux keufs : « Tout le monde déteste la police » est un slogan plus agréable à entendre et plus intelligent que « Je suis Charlie, je suis policier » ou « La police avec nous »…
mais ce n’est pas une vérité. Il n’est d’ailleurs pas prononcé par les
mêmes personnes, ni par le même nombre de personnes. On voit néanmoins
que la propagande liée à l’état d’urgence a des limites.
Certains ont critiqué une focalisation anti-flics(9) éventuellement préjudiciable, car les flics ne sont théoriquement pas un objectif mais un obstacle entre nous et notre objectif, et la révolution pas un duel entre émeutiers et CRS.
- Ensuite, la façon dont elle a été
perçue. La question a été débattue à ND : ce n’est pas tant les
« débordements » qui ont été tolérés, que « la violence » comme mode
d’action et d’expression politique qui a été discutée et acceptée (comme
l’est par ailleurs le macramé non-mixte)(7). Cela aurait été inimaginable entre 1999 et 2010 où le moindre bris de vitre était stigmatisé comme l’œuvre de flics en civil(8).
Les coordinations nationales étudiantes et lycéennes ont également refusé de se désolidariser des manifestants désignés comme « casseurs » par les journalistes et les flics.
À Paris, dans le cortège de tête à partir duquel beaucoup agissaient, des milliers de manifestants complices, solidaires ou indifférents étaient présents.
Cette évolution est significative mais, là aussi, il ne faut pas se tromper : ce nouveau rapport à la violence reste là aussi très minoritaire. Caillasser des CRS ou briser une vitrine de banque sont toujours condamnés par la majorité des manifestants sinon des militants. C’est aussi le fait d’atteindre une masse critique (en cortège de tête, dans une très grande ville) qui met en place une sorte de rapport de force et fait que certains tolèrent ce type d’action.
- La gestion étatique : les forces de
l’ordre ont pour fonction de contenir ou réprimer les manifestants ;
elles ont fait leur boulot. Il n’y a donc pas de bon usage des
CRS à revendiquer. Le fait qu’elles aient testé de nouvelles armes et
techniques n’est pas très significatif, elles le font depuis une
centaine d’années.
Choisir de réprimer (empêcher) ou de laisser faire (casser) pour se contenter de canaliser dépend de considérations et opportunités politiques, puis techniques. Et malgré la « fatigue » occasionnée par des mois d’état d’urgence, les flics ont pu aisément gérer des violences limitées à quelques villes. À leur éventuel débordement tactique aurait simplement répondu une montée en puissance de la répression alors que les émeutiers n’auraient pu s’appuyer sur un mouvement social fort. Ceux qui en doutaient savent maintenant que l’État dispose d’une panoplie de moyens lui permettant de mettre un terme immédiat à ces agissements… à condition d’avoir le concours des syndicats (voir la manifestation en cage du 23 juin 2016 à Paris). Cela a évidemment un coût matériel, financier et politique pour une efficacité provisoire (le temps de trouver comment contourner les dispositifs).
La violence n’est pas forcément prolétarienne. Elle peut aussi, dans certains cas, être l’œuvre de jeunes membres de la classe moyenne (au Vénézuela par exemple) et son caractère prolétarien n’est pas non plus suffisant (des émeutes peuvent aussi être racistes ou nationalistes). La violence est un outil. C’est aussi un marqueur, sorte de thermomètre du moment social mais qui ne suffit pas à dire où nous sommes.
Et demain tu fais quoi ?
Ce mouvement me laisse une impression étrange, comme s’il n’avait été que l’esquisse (au sens artistique) d’un mouvement, ou bien un faux trop apparemment spectaculaire… Comme si la seule possibilité était de (tenter de) singer le mouvement précédent… comme l’énième photocopie d’une photocopie sur une machine à bout de souffle… On n’y voit plus grand chose.
Où sommes-nous ? Il y a cette idée qui hante, celle d’une transition. Revenons un peu en arrière. Après l’ouverture par les socialistes en 1983 de la célèbre « parenthèse », la grève de décembre 1995 inaugure une période de résistance contre l’alignement du capitalisme français sur le modèle dit néo-libéral. La possibilité de la grève générale fait son retour dans l’imaginaire, cheminots en avant-garde (dockers pour les villes portuaires), fonctionnaires en nombre, lycéens et étudiants en piétaille agitée… Une sorte de modèle à suivre, que beaucoup ont en tête tout au long de ces années de luttes défensives et… de défaites. 1995, 2003, 2006 (seule « victoire »), 2010, 2016.
L’hiver 1995 a en fait inauguré le concept de « grève par
procuration » : une minorité (fonctionnaires, entreprises publiques,
bastions syndicaux du privé) cesse le travail, soutenue par une masse de
travailleurs qui n’aurait pas « la possibilité » ou « les moyens » de
faire grève mais qui parfois se rend aux manifs ; sans oublier l’opinion
qui, sondages à l’appui, approuve. Or, depuis 2003, les manifestants ne
cessent de se plaindre de l’inefficacité de ces défilés traîne-savates,
des grèves au carré, des « magouilles » syndicales, etc., et les rangs
se clairsèment. La grève par procuration a montré ses limites.
Aujourd’hui, en un mouvement dispersé, tronçonné et ultra-minoritaire,
la minorité qui se mobilise se réduit aux militants et syndiqués. Le
mythe de la grève n’a pas du plomb que dans l’aile. Quant aux
« nouvelles » pratiques (AG de lutte, assemblées, casse, etc.) dont on
espère à chaque fois la généralisation, elles ne bouleversent aucunement
la production(10).
Elles font plaisir mais sont plus le signe d’une décomposition que d’un
dépassement car elles ne germent que sur les marges d’un mouvement en
ruine.
Est-ce la fin d’un cycle de luttes ? Pas des luttes, évidemment, ni de
la lutte des classes ou du prolétariat. Mais, entre l’implication
croissante d’une classe moyenne inquiète et les tentations populistes,
peut-être va-t-on assister à de nouvelles formes de « mobilisation »
dont les ND, l’ovni Bonnets rouges ou, pourquoi pas, la Manif pour tous,
n’ont été que de peu ragoutantes préfigurations(11)…
En temps de désespoir chronique, les marchands de soupe espèrent faire fortune. Les militants gauche(s) de la gauche qui ont formé les gros bataillons dans la lutte contre la loi Travail sont conscients du malaise. Ils savent qu’entre le mouvement des Indignados et la création de Podemos, leur nouveau modèle, trois années se sont écoulées et qu’il s’agit d’ores et déjà de miser sur ce qu’ils croient être les bons chevaux. Mais ils ont aussi en tête cet autre exemple, celui de Syriza, coalition des débris de la social-démocratie et d’extrême-gauche, qui n’aura mis que dix ans pour arriver au pouvoir en Grèce (en s’alliant avec un petit parti d’extrême-droite)… et six mois pour « trahir » ses électeurs. Leur issue de secours est une voie sans issue.
Ces politiciens aux habits neufs qui prétendent nous montrer ce qu’est
une « vraie » gauche, nous redonner goût à la « vraie » démocratie, ont
sans doute marqué des points dans le mouvement, notamment auprès de la
classe moyenne qui fréquentait les ND… mais le dégoût du politique en a
sans doute aussi marqué beaucoup, en particulier chez les grévistes.
Désillusion serait un grand mot, disons plutôt une confirmation. Si même
« la gauche » roule ouvertement pour le MEDEF et fait
flash-baller vos copains et vos enfants, où va-t-on ?! Encore une fois,
repli, identité, abstention ou vote « extrême »… ? D’ailleurs, combien y
avait-il d’électeurs du FN à tes côtés ce jour-là sur ce blocage si
« déter » ?
Que nous réserve l’avenir ? Les lendemains ne chanteront pas et ils auront une sale gueule. Trop pessimiste et négatif ? Disons en tout cas que, dans les prochaines années, nous ne manquerons pas d’occupations ! Et que les surlendemains ne peuvent pas être pires. Non ?
Clément
(1) C’est bien
souvent l’une des fonctions des gouvernements de gauche que de mettre en
œuvre des mesures qui, si elles étaient à l’initiative de la droite,
entraîneraient immédiatement une vive riposte. En fait il s’agit le plus
souvent d’ouvrir des brèches,par exemple dans le Code du Travail (ANI,
lois Macron, etc.), que n’auront qu’à exploiter et élargir les
gouvernants suivants.
(2) Il y avait eu juin 1936 mais, à l’époque, les
travailleurs croyaient que le gouvernement de Blum était de leur côté.
[voir plus loin «The Great Front Populaire Swindle»]
(3) La CGT n’a véritablement appelé à la grève
générale qu’à deux reprises, en juin 1936 et mai 1968 : à deux moments
où, sans l’intervention des syndicats, la grève générale se répandait
comme une traînée de poudre à travers le pays. Dans ces deux cas il
s’agissait pour la CGT d’essayer de se placer à la tête du mouvement.
(4) George Romero sors de ces corps !
(5) Nous arrêterons ici le ND-bashing auquel il faudrait consacrer plusieurs pages.
(6) Voir l’article de Jean-Pierre Duteuil, « Mettre la classe ouvrière à genoux », Courant Alternatif, n° 262, été 2016.
(7) A noter qu’en 2006 et 2010, affrontements et
« débordements » (parfois accompagnés de pillages) s’étaient généralisés
dans l’Hexagone et étaient souvent moins le fait de « militants » que
d’incontrôlables lycéens.
(8) Comment expliquer cette évolution ? La violente
répression qu’ont subie les manifestants n’est pas une explication
satisfaisante. À Gênes, en 2001, la répression pour le coup « féroce »
et allant jusqu’à la mort d’un manifestant, n’avait pas empêché les
crapules citoyennistes (dont Attac) de dénoncer les « mauvais »
manifestants comme des « casseurs »/flics infiltrés.
(9) Les syndicats de police, à la pointe de la
post-modernité, n’ont pas manqué de dégainer le concept de
« flicophobie ». Un ouvrage sur ce thème serait en préparation aux
éditions La Fabrique.
(10) Le pire étant sans doute Nuit Debout-Paris car
une fois la Place de la République quittée, la métropole parisienne vit
à plein régime comme si de rien n’était… On est là dans le
mouvement complètement séparé du reste de la vie y compris pour les
participants (on y passe le soir après le boulot), alors que l’intérêt
d’une lutte et en particulier d’une grève, est de briser le
fonctionnement normal de la production et de la vie.
(11) Sur cette idée perverse voir Gaël Brustier, #Nuitdebout. Que penser ?, Paris, Cerf, 2016, 112 p.
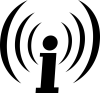

Ein Nachschlag...
...zur Debatte über die Bewegung gegen das loi travail aus dem Dezember.